
[vz_message type=” 4″] Second article collectif d’une série de six, sur la problématique des frontières.
1er article ici
Focus sur le plateau anatolien et le sud-Caucase[/vz_message]
L’Anatolie et le sud Caucase illustrent la complexité du fait politique. Des côtes méridionales de la Mer Noire aux côtes occidentales de la Caspienne, les puissances se sont toujours affrontées. D’Alexandre le Grand aux empires européens, en passant par Pompée et les califes, chacun a tenté d’influer sur ce verrou stratégique. Pourtant ce sont bien les conditions du règlement des effondrements ottoman et soviétique qui pèsent aujourd’hui sur les liens régionaux.
Peuples, nations et ethnies : une mosaïque ethnolinguistique
La diversité linguistique est l’une des caractéristiques fondamentales du Caucase et de l’Anatolie. Ainsi s’entrecroisent les langues indo-européennes, ouralo-altaïques et celles caucasiques. Du point de vue confessionnel, l’histoire du Caucase est marquée par la présence des trois grandes religions monothéistes, l’Islam étant le plus représenté. Le christianisme est la religion dominante en Arménie et en Géorgie. Le judaïsme a vu une baisse substantielle du nombre de ses fidèles dans le Caucase, notamment depuis la création de l’État d’Israël en 1947.
Parmi l’ensemble des États étudiés, l’Arménie est celle qui tend à une quasi-homogénéité ethnique. 96 % des ressortissants sont arméniens, les quatre pour cent restants étant Russes, Yézidis, Kurdes, Assyriens, Grecs, Ukrainiens et Juifs. Cette homogénéité s’explique d’abord par l’ancrage antique du peuple arménien sur l’axe Anatolie-Caucase. D’autre part, la nature montagneuse de l’Arménie rend son accès difficile et crée une frontière naturelle avec ses voisins. Enfin, l’afflux massif d’Arméniens victimes des persécutions ottomanes a contribué à l’homogénéisation de la République d’Arménie.
L’Azerbaïdjan compte une population de plus de neuf millions de personnes, principalement musulmane. L’Islam est implanté en Azerbaïdjan depuis le VIe siècle, mais c’est au XVIe siècle que la population s’est convertie au Chiisme duodécimain. Ainsi, sur 93 % de musulmans, 85 % sont chiites. Les autres ethnies présentent son russe orthodoxe et Arménienne apostolique. Le peuple azéri est à la croisée d’origines turcomanes et iraniennes. En effet si la langue fait partie de l’ensemble altaïque, il existe des similarités culturelles entre Persans et Azéris. L’Azerbaïdjan avant l’arrivée des Oghouz avait des liens forts avec le monde persan. Finalement, il est possible de dire que les Azéris sont des Caucasiens ayant intégré les rites et les traditions iraniennes et turques.
La Turquie compte près de 80 millions d’habitants. La population majoritairement musulmane (80 %) compte une minorité alévie issue du chiisme duodécimain. L’Alévisme n’est pas officiellement reconnu par les institutions turques. Les Kurdes constituent aussi une minorité importante, ils représentent en effet un cinquième de la population. Ils occupent essentiellement le sud-est du pays et leur langue indo-européenne entre dans la catégorie des langues iraniennes occidentales. Au même titre que la majorité turque, les Kurdes sont pour la plupart sunnites.
Un carrefour géostratégique de première importance
L’incidence du poids de l’histoire sur les relations régionales
La Turquie, à bien des égards, peut être considérée comme l’État dominant l’axe Bosphore-Caspienne. Fort de son appartenance aux organisations régionales et à l’OTAN, la Turquie est une interface de premier ordre. L’État moderne a émergé des cendres de l’Empire ottoman et a su s’imposer dans le concert des nations. Loin d’être anecdotique, la reconquête politique et militaire de la profondeur stratégique anatolienne par Atatürk est à la source de la diplomatie turque. Istanbul a su revenir sur le traité de Sèvres par le biais de celui de Lausanne, annihilant de fait les prétentions territoriales kurdes ou arméniennes.
Utilisant les enjeux de pouvoirs de la région, la Turquie a su s’accorder avec le monde soviétique, tout en ménageant sa politique occidentale. Le cas arménien reste pourtant symptomatique des maux entre la Turquie et ses voisins. Les pogroms et le génocide arménien prenant racine dans les idées pantouranistes et la vision turque de l’Arménie comme « cinquième colonne de la Russie » [1] ont attisé les tensions stratégiques. La Turquie a toujours tenté d’utiliser le jeu des puissances à son avantage, oscillant entre un national-neutralisme, un atlantisme modéré et une prétention régionale. Istanbul et Bakou ont des relations fortes occultant l’antagonisme religieux, au profit d’une communauté sémiologique.
L’axe Caspienne-Méditerranée, pivot stratégique entre Europe et Moyen-Orient
Depuis les années 2000, la politique occidentale turque semble s’infléchir dans ses moyens comme dans ses buts. Si depuis 1943 le partenariat entre Turcs et Américains reste structurant, les évolutions récentes ont modifié les relations turco-occidentales. D’un côté, le partenariat pour la paix a permis à Istanbul de renouer des relations privilégiées avec les Balkans. L’importance des forces nationales et sa position ont fait de l’Anatolie turcomane une plateforme pour les forces atlantiques. De l’autre, la doctrine Davutoglu portée par un courant néo-islamiste attire la Turquie vers ses frontières méridionales. En interne, l’armée semble perdre son rôle de régulateur au profit d’une démocratie viciée. En somme, la Turquie s’ancre plus à son identité musulmane qu’à son héritage kémaliste.
Les turbulences au sein des États panarabes sont source d’opportunités, mais aussi de menaces pour l’État turc. Si la mise au ban des nations de la Syrie ouvre un canal d’influence dans l’environnement turc, la contagion irrédentiste n’est pas à écarter. Finalement, la Turquie est actuellement à un carrefour de son histoire : les tensions internes et externes fragilisent son soft balance traditionnel. S’il est difficile de définir formellement le futur de la diplomatie turque, il y a fort à parier que l’ambivalence entre son identité musulmane, l’idéal turcoman et l’ancrage euro-méditerranéen finira de modifier durablement sa position dans la région.
L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont un destin commun récent. Jouissant d’une indépendance nationale suite à la dislocation soviétique, leurs relations sont très liées. Ces États limitrophes doivent faire face aux conséquences géopolitiques de l’enclave. Ainsi la région azérie du Nakhitchevan est séparée de Bakou par le territoire arménien, les territoires azéris derrière la ligne de cessez-le-feu et l’enclave orpheline[2] arménienne du Nagorno-Karabakh. Ces deux enclaves ont conduit à une lutte armée au début des années 1990, dont les enjeux pèsent encore aujourd’hui dans la région.
La période fédérale communiste ne viendra que geler le contentieux qui finira par se déclencher, à la suite du référendum d’indépendance du Karabakh arménien et de heurts ethniques. Pour l’Arménie, fermeture frontalière et blocus turc entérineront un enclavement géographique et politique. Seuls l’Iran et la Russie resteront des partenaires. Avec le Nagorno-Karabakh, on assiste à l’apparition d’un quasi-État[3], enclave ethnopolitique née de la désintégration de l’URSS, possédant le soutien arménien, mais étant non reconnue par la communauté internationale.
Bien que ce quasi-État doive son existence à la persistance des tensions entre son État protecteur (Erevan) et l’État territorialement compétent (Bakou), son avenir ne laisse que peu d’opportunités. Ce territoire devra soit être réintégré ou absorbé. Un élément fait aujourd’hui consensus : les deux États pâtissent de leur opposition – leur proximité géographique et les interdépendances qui en découlent devraient signifier une coopération politique accrue.
L’énergie catalyseur des enjeux de pouvoirs
Objet géopolitique de premier ordre, l’énergie est à la source des rivalités territoriales. Le passage de la population turque entre 1950 et 2012 de 21,5 à 80 millions a augmenté les besoins agricoles. L’intensification induite par cette croissance nécessite un apport considérable en eau. Cette région constitue un « château d’eau » grâce au Tigre, à l’Euphrate, l’Araxe ou encore la Koura qui sont des fleuves partagés entre États. Ils s’inscrivent dans une géologie complexe, inexorablement structurante des systèmes hydriques.
Les ressources hydrauliques turques sont concentrées à l’Est alors que la population vit plutôt à l’Ouest. Le Tigre et l’Euphrate[4] alimentent la Turquie sud orientale, l’Irak et la Syrie. La Turquie contrôle dorénavant 86 % du débit de l’Euphrate[5] grâce aux aménagements du GAP. L’achèvement du projet du barrage d’Ilisu sur le Tigre prévu pour 2016 l’amputerait de 10 milliards de m³ d’eau, le quart de son débit à son entrée en Irak[6]. Toutefois, la crise d’approvisionnement de 2007 a mis en exergue les carences de la planification hydraulique alors que le pays s’est engagé à fournir de l’eau à Chypre et à Israël. Malgré de faibles ressources en hydrocarbures, la Turquie bénéficie d’un levier certain sur les pays en aval.
L’agriculture représente encore à ce jour plus de 20 % du PIB arménien. L’Arménie sillonnée de cours d’eau abrite l’immense lac Sevan. Le fleuve Araxe couvre le territoire, traverse la Géorgie et l’Azerbaïdjan pour se jeter dans la Koura. Des affluents de l’Araxe et de la Koura naissent dans le Karabakh. Le débit fort des cours d’eau du Haut-Karabakh assure un approvisionnement en énergie. Le point culminant de Karvachar fournit plus des trois quarts de ressources en eau du Haut-Karabakh[7].
67 % du débit des fleuves de l’Azerbaïdjan proviennent de l’extérieur. La Koura y représente jusqu’à 80 % de l’eau consommée[8]. Le canal allant jusqu’au réservoir de Djeiranbatan alimente l’agglomération de Bakou, où réside le tiers des Azéris. En outre, l’eau de la Koura et de l’Aras est polluée lors du passage en Arménie et en Géorgie. La gestion conjointe des eaux est peu probable au regard des tensions actuelles.
Carrefour naturel entre l’Europe et le bassin Caspien, l’Anatolie constitue une interface Nord-Sud entre Mer Noire et Méditerranée. Le rôle du corridor anatolien questionne la plateforme turque. Le territoire du pays est constitué d’une interface naturelle de transit entre les États orientaux et caucasiens, détenteurs des plus grandes réserves mondiales de ressources fossiles et le marché de consommation européen. La Turquie s’est imposée au fil des constructions d’oléoducs, comme un corridor « est-ouest » privilégié et est devenue, au début des années 1990, une pièce centrale du complexe puzzle des pipelines.
Grâce à l`oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et celui Kirkouk-Yumurtalik, la Turquie assure environ 4 % du transit du pétrole mondial. À ce flux terrestre, il faut également ajouter les 3 millions de barils quotidiens de pétrole russe et kazakh qui transitent à travers les détroits maritimes turcs depuis le terminal de Novorossisk sur la mer Noire. Cette position est renforcée depuis l’exportation du pétrole « fédéral » du Kurdistan irakien – processus contesté par le gouvernement central irakien. Le complexe pétrochimique de Ceyhan s’affirme de plus en plus comme le véritable hub pétrolier de la Turquie.
L’ambition de la Turquie n’est pas de rester un simple pays de transit, mais de devenir une plaque tournante gazière, afin de sécuriser et diversifier ses approvisionnements. Le projet Southern Gas Corridor incluant le Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP), a pour but de diminuer l’influence régionale russe, en renforçant le rôle turc et azéri. La Russie a lancé un projet concurrent au TANAP le South Stream, mais il a été rejeté par les Européens, dont la Bulgarie. Face à cet échec, la Russie a entamé des discussions bilatérales avec la Turquie pour un éventuel Turkish stream répondant aux attentes des acteurs.
L’Azerbaïdjan, qui dispose des ressources d’hydrocarbures estimées à environ 0,9 milliard de mètres cubes[9] souhaite s’affranchir de l’influence russe sur ses ressources et réseaux de transport. Aujourd’hui, la construction du corridor sud-européen, dont le TANAP constitue la partie la plus importante, permet à l’Azerbaïdjan d’exporter son gaz par une ligne directe de plus de 2 500 kilomètres qui débouche directement à l’intérieur de l’Union européenne. Les ressources azéries ne suffissent pas à satisfaire la demande croissante de la Turquie et des pays européens, c’est pourquoi le développement du corridor sud-européen, via la construction du Trans-Caspian Pipeline (TCP) est essentiel. Il devrait relier les gisements turkmènes au réseau de transport azéri en traversant la Caspienne.
Le hub énergétique anatolien doit faire face à des luttes de pouvoirs. Comme le signale la possible création du TANAP, les États sont en concurrence pour la gestion des ressources. Le désaccord entre Azerbaïdjan et Turkménistan autour du Trans-caspian Gas Pipeline, les tumultes concernant l’extraction des réserves off-shore et la vulnérabilité accentuée des pipelines face aux sabotages du PKK, montrent que l’énergie est un facteur déterminant du fait géopolitique de dans cette région.
Mise en perspective d’une redéfinition moins arbitraire des tracés limitrophes
Une remise en cause des frontières, sources de déstabilisation pérenne des relations régionales
De nouvelles frontières telles que définies par Ralph Peters auraient plusieurs vertus dans le sud Caucase. Premièrement, elles régleraient l’impact des enclaves arméno-azéries. Ainsi, le Nagorno-Karabakh serait de facto intégré au territoire arménien de même qu’une partie du territoire sous contrôle d’Erevan au sud de la ligne du cessez-le-feu. L’Arménie gagnerait également sur son flanc ouest avec l’intégration plus ou moins partielle du Mont Ararat, lieu hautement symbolique pour la nation arménienne. Au nord comme au sud, les frontières resteraient inchangées. Même si les frontières ne coïncident pas avec la grande Arménie, les frontières du sang auraient le mérite de réduire les effets pervers de l’enclavement tel que le sentiment obsidional. Pourtant elle n’aurait toujours pas une façade maritime sur la Mer Morte comme convenu lors du traité de Sèvres. De son côté, l’Azerbaïdjan obtiendrait une continuité territoriale pour rattacher le Nakhitchevan, en obtenant des territoires jusqu’à la ville de Rasht au détriment de l’Iran.
Pourtant loin de résoudre les tensions ethno politiques, ces possibles tracés frontaliers laissent en suspend de nombreuses questions. L’exclave d’Erevan à Artsvachen et les ancrages azéris en Arménie resteraient dans leur territoire respectif. Ajoutons à cela que toute remise en cause des tracés est conditionnée aux accords de volonté de l’Iran et de la Turquie. Or, la Turquie comme l’Iran pâtiraient d’une quelconque modification de leurs frontières, d’autant que l’un comme l’autre souhaite avoir une influence régionale de premier ordre. L’ambivalence du droit international sur les tracés territoriaux s’ajouterait aux réticences politiques et conduirait à des tensions accrues.
Les interactions profondes entre tracé territorial et contrôle du devenir énergétique
La refonte des frontières selon Ralph Peters rebattrait les cartes dans la région en faveur du Kurdistan. Le Kurdistan disposerait d’une grande zone fertile, ancien sol syro-irakien ainsi que le lit du Tigre et de l’Euphrate, faisant de cet État un acteur puissant du Moyen-Orient.
Un redécoupage des frontières permettrait aux Kurdes turcs de jouir de l’autonomie kurde en Irak. En effet, les Kurdes irakiens ont l’opportunité de construire seuls un pipeline d’une capacité quotidienne d’un million de barils. Ce pétrole kurde serait contrôlé par et au profit des populations kurdes. Ces ressources étant transportées vers le hub turc.
En raison des sujets délicats du génocide arménien et du Haut-Karabakh, l’Arménie n’a pas de relations diplomatiques avec la Turquie ni l’Azerbaïdjan. Ainsi elle reste fortement isolée des grands projets énergétiques régionaux. Le pays est dépendant de la Russie à hauteur de 80 % de ses importations. Pourtant, le pays a commencé les négociations avec l’Iran pour la construction d’un pipeline de pétrole similaire à celui de gaz fonctionnant depuis 2007. Une refonte des frontières aurait sans nul doute des conséquences néfastes, car l’Arménie perdrait sa frontière avec l’Iran. Cela rendrait encore plus pressant le besoin d’une coopération entre Erevan et Bakou.
Quasi et proto-États aux sources d’une modification de facto des limites territoriales
L’accession de la communauté kurde à l’État est mise en avant par Peters. Dans les configurations actuelles, le Kurdistan irakien du fait de son autonomie est proche d’être un proto-État kurde. Obtenant une façade maritime en Mer Noire, il couperait définitivement l’Anatolie et le Caucase. La création du Kurdistan contribuerait donc à la poursuite de l’enclavement arménien puisqu’Erevan ne profiterait pas du retrait turc. Ces deux États pourraient tout de même faire front communs contre la Turquie. Un bloc pourrait ainsi se former contre Ankara, ce qui aurait pour conséquence une déstabilisation profonde de la région. Pour autant, la logique ethnique de Ralph Peters serait respectée dans le cas kurde, car ceux-ci constituent un bloc homogène au Moyen-Orient.
L’horizon politique de la conciliation semble éloigné et l’activité de l’État Islamique pourrait jouer sur les limites des États. Si la pérennité de son contrôle territorial n’est pas actée, l’avancée rapide de l’État Islamique ces derniers mois a mis sous pression les États frontaliers. Tant la porosité des frontières que l’absence d’une réponse politique acceptée par tous nourrissent l’instabilité régionale. La campagne du groupe qui a mis à nu la frontière sud de la Turquie dans le Nord syrien, pourrait déboucher sur des incursions en territoire turc. Le franchissement des frontières et la lutte ouverte entre Kurdes et Daesh pourraient conduire, à la suite du conflit, à des frictions entre autorités compétentes et combattants peshmergas. Le contrôle d’un territoire politiquement turc, mais faisant partie intégrante du Kurdistan de Sèvres pourrait donner lieu à un nouveau tracé de facto.
Si ces pistes de réflexion restent hypothétiques, elles mettent tout de même en lumière la complexité des enjeux de pouvoirs dans une région où chaque État doit face à un environnement particulièrement instable. Plateau anatolien et Sud Caucase sont des interfaces essentielles au bloc eurasiatique, et la coopération est l’élément central qui permettra une véritable stabilisation de la région.
Alexia Tinant, Arthur Bachmann, Milen Zhelev, Quentin Voutier, Stéphane Hamalian
[1] MONGRENIER Jean-Sylvestre, « L’État turc, son armée et l’OTAN : ami, allié ou non aligné ? », Hérodote, La Découverte, n° 148, 2013, pp. 47 – 67.
[2] Enclaves sans appartenance clairement établie. NIES Susanne, « Les enclaves : “volcans” éteints ou en activité », Revue internationale et stratégique, Armand Colin/Dunod, n° 49, 2003, pp. 111 – 120.
[3] RYWKIN Michael, « Le phénomène des “quasi-États” », Diogène, PUF, n° 210, 2005, pp. 28 -33.
[4] ŞANVAR BOUCHER NurÁin, Fiche de synthèse, MINEFI-DREE, juillet 2001, p. 1.
[5] MUTIN George, Géopolitique du monde arabe, 3e édition, Carrefour, Ellipses, 2009, p. 113.
[6] LACHKAR Michel, « L’eau, l’autre facteur du conflit syrien », Geopolis, mars 2015 : http://geopolis.francetvinfo.fr/leau-lautre-facteur-du-conflit-syrien-55777.
[7] OHANYAN Karine, “Water complicates Karabakh peace talks”, Institute of War and Peace, 2010 : https://iwpr.net/global-voices/water-complicates-karabakh-peace-talks.
[8] THOREZ Pierre et THOREZ Julien, « Le partage des eaux dans les républiques d’Asie centrale, manifestation des tensions post-soviétiques », Cahiers d’Asie centrale, 13/04/2004, p. 10.



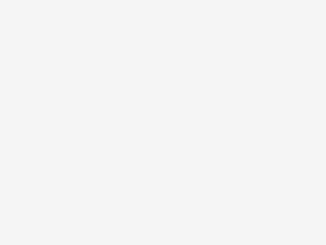


Soyez le premier à commenter